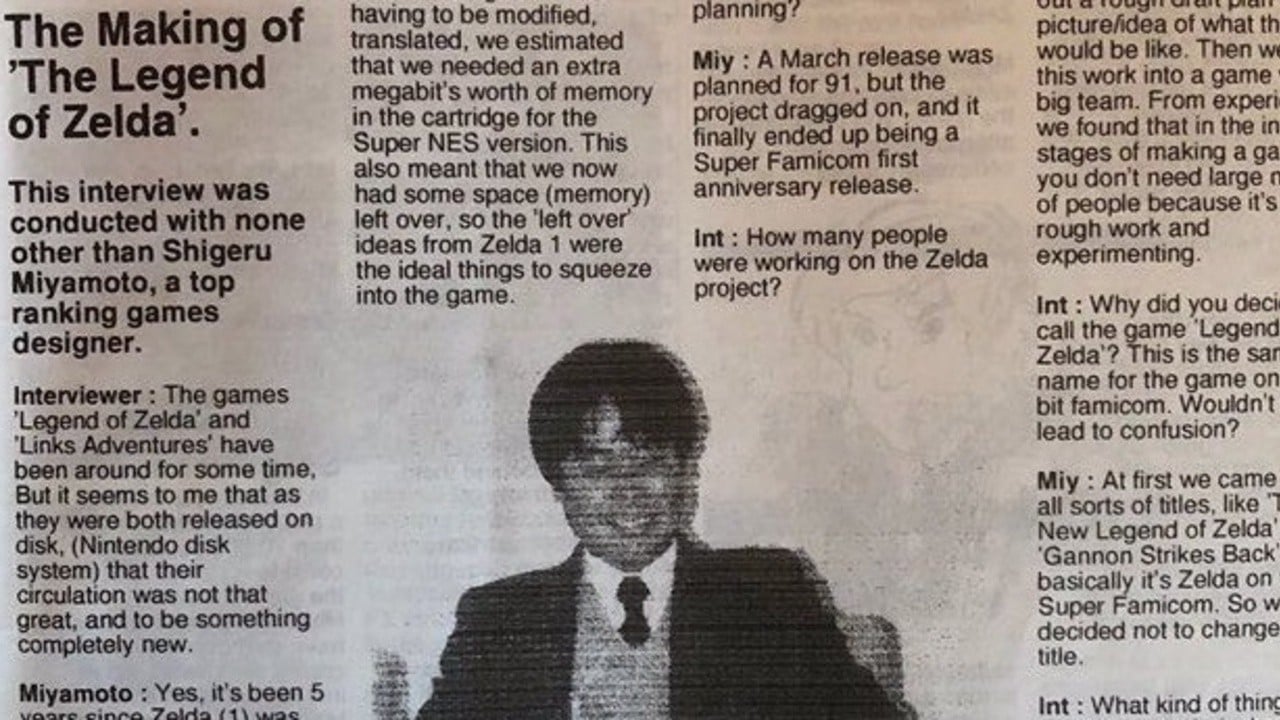L’année 1986 marque une autre étape décisive dans l’histoire de Nintendo et dans le parcours de Shigeru Miyamoto. Après avoir conquis le monde avec Super Mario Bros., il dévoile une nouvelle œuvre radicalement différente : The Legend of Zelda. Avec ce jeu, Miyamoto ne cherche plus seulement à divertir. Il veut désormais faire vivre une aventure intérieure, au sein d’un monde que le joueur doit apprivoiser à son rythme, sans guidage explicite.
L'éveil du concept de "monde ouvert"
Pour la première fois dans un jeu Nintendo, le joueur n’est pas poussé vers la droite ni enfermé dans un parcours linéaire. Il est lâché dans un monde vaste, inconnu, et déroutant, sans carte initiale, sans didacticiel, sans flèches indicatrices. Le sentiment premier est celui de la désorientation volontaire. C’est voulu. Miyamoto dira plus tard :
« Je voulais recréer le sentiment que j’avais enfant, lorsque je partais explorer les bois près de chez moi. Je ne savais jamais ce que j’allais découvrir — un lac, une grotte, ou parfois… rien. »
Avec Zelda, le jeu vidéo devient exploration, contemplation, progression non dirigée. L’espace de jeu cesse d’être un couloir pour devenir un monde habité, structuré en zones, secrets, connexions internes, et surtout non dévoilé d’emblée.
Ce n’est pas un monde réaliste, mais un monde crédible. Ce n’est pas une narration imposée, mais une aventure organique, tissée par la curiosité du joueur lui-même.
L’invention d’un nouveau pacte joueur-jeu
Miyamoto rompt ici le contrat implicite de la génération précédente de jeux vidéo, fondés sur la performance, le score, ou le challenge pur. Avec Zelda, il fonde un nouveau pacte de confiance entre le joueur et le concepteur :
« Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire. Mais si tu explores avec attention, je t’ai laissé tout ce qu’il faut pour t’y retrouver. »
C’est une approche révolutionnaire. Le joueur n’est plus un exécutant, il devient un archéologue d’univers. Il doit cartographier, expérimenter, hypothétiser. Ce que Zelda inaugure, c’est la possibilité d’un jeu comme langage du mystère, et le plaisir de la découverte comme forme de narration implicite.
La naissance du mythe comme structure de jeu
Dans Zelda, il ne s’agit pas simplement de sauver une princesse ou de vaincre un méchant. Il s’agit de retrouver des fragments d’un monde perdu, de reconstruire une légende, pièce par pièce. On y entre comme on entre dans un conte ancien dont les pages seraient effacées, et qu’on doit réécrire soi-même.
Miyamoto n’a pas seulement créé un jeu. Il a instauré une nouvelle structure mentale pour le joueur :
une carte à remplir,
des objets à réinterpréter,
des énigmes non résolues à première vue,
et un monde qui ne donne ses clés qu’aux explorateurs patients.
Il crée ainsi le socle de ce que deviendra plus tard le jeu vidéo narratif non linéaire, de Metroid à Dark Souls, de Skyrim à Breath of the Wild. Tout commence ici : une promesse de liberté, d’immersion et d’autonomie du joueur.